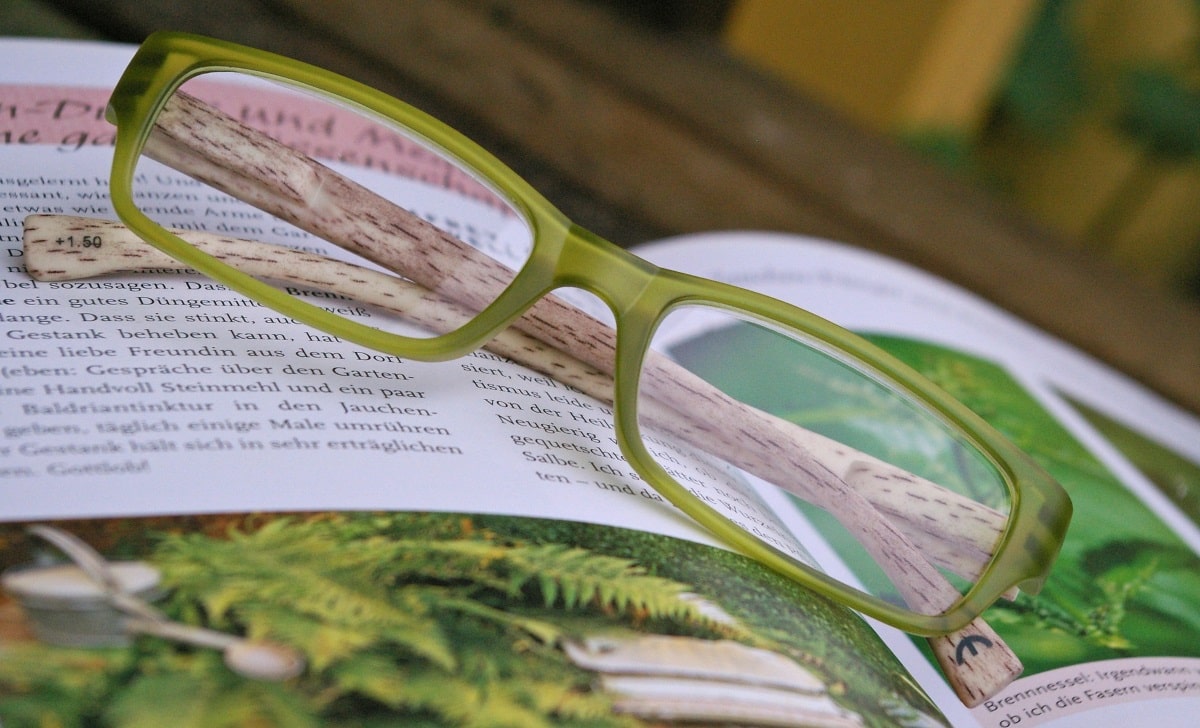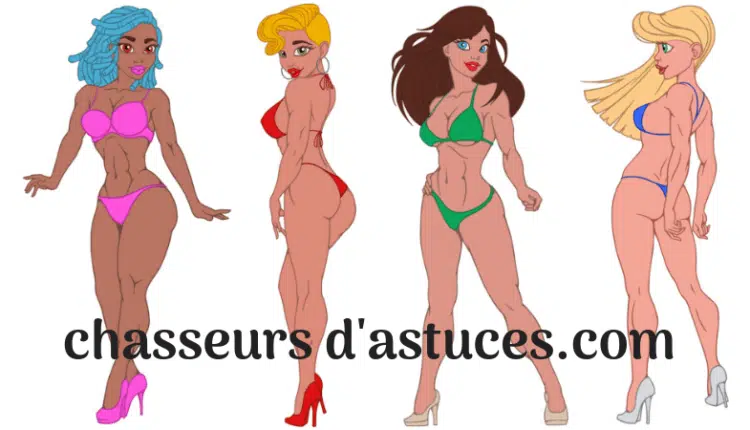En 2025, le choléra reste une menace mondiale, particulièrement dans les régions où l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires est limité. Malgré les avancées médicales, la maladie persiste dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, touchant des millions de personnes chaque année.
La propagation du choléra est principalement due à la contamination de l’eau par la bactérie Vibrio cholerae. Les efforts de prévention se concentrent sur l’amélioration des infrastructures sanitaires, la distribution de vaccins et les campagnes de sensibilisation. Les communautés locales jouent un rôle fondamental en adoptant des pratiques d’hygiène rigoureuses pour réduire l’incidence de cette maladie.
Prévalence mondiale du choléra en 2025
En 2025, le choléra continue de sévir dans plusieurs régions du monde, avec des foyers particulièrement virulents en Afrique, en Asie et en Amérique latine. La République Démocratique du Congo (RDC) reste l’un des principaux foyers d’infection, notamment dans la région de Kalémie, située dans le Tanganyika. Cette zone enregistre 61 % des cas de choléra répertoriés en RDC, où seulement 49 % des habitants avaient accès à une source d’eau « sûre » en 2013.
Quelques épidémies notables
- Mayotte : En avril 2024, une épidémie de choléra s’est déclarée dans ce département français, faisant suite à une épidémie aux Comores en février 2024.
- Haïti : L’épidémie de choléra ayant débuté en 2010 demeure un problème de santé publique majeur.
- Yémen : Depuis 2016, une épidémie de choléra sévit dans le pays, aggravée par la guerre civile.
- Liban et Syrie : Les deux pays ont été touchés par des épidémies en 2022, exacerbées par l’instabilité régionale.
Solidarités International, une ONG active dans la lutte contre le choléra, intervient dans plusieurs de ces régions critiques, notamment en RDC et au Nigéria, où le bassin du Lac Tchad reste une zone fortement touchée. Ces interventions incluent des campagnes de vaccination, l’amélioration des infrastructures sanitaires et la sensibilisation des populations locales aux pratiques d’hygiène.
Causes et modes de transmission
Le choléra, une infection diarrhéique aiguë, est causé par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminés par la bactérie Vibrio cholerae. Cette bactérie se divise principalement en deux sérogroupes responsables des épidémies : O1 et O139.
La bactérie produit une toxine cholérique, qui provoque des pertes importantes d’eau et d’électrolytes chez l’hôte infecté. Les principales sources de contamination sont les zones où l’accès à une eau potable et à des infrastructures sanitaires adéquates est limité. Le delta du Gange en Inde est considéré comme une source permanente de nouvelles souches de Vibrio cholerae.
Modes de transmission
- Eau contaminée : Les principales épidémies de choléra sont souvent liées à la consommation d’eau contaminée.
- Aliments contaminés : Les fruits de mer, en particulier les coquillages, et les aliments crus ou mal cuits peuvent être des vecteurs de la bactérie.
- Transmission interhumaine : Bien que moins fréquente, la transmission peut se produire dans des conditions d’hygiène précaires.
La lignée El Tor, une variante génétique de Vibrio cholerae, est responsable de la majorité des épidémies modernes. Elle est particulièrement résistante et capable de persister dans l’environnement aquatique, rendant la lutte contre la maladie d’autant plus complexe. Considérez que la prévention passe par une amélioration significative de l’accès à une eau potable et des infrastructures sanitaires adéquates.
Symptômes et diagnostic
Le choléra se manifeste par une diarrhée aqueuse aiguë, souvent décrite comme de l’eau de riz en raison de son apparence blanchâtre et liquide. Cette diarrhée peut entraîner une perte rapide de liquides corporels, allant jusqu’à un litre par heure, conduisant à une déshydratation sévère.
Les autres symptômes incluent :
- Vomissements, apparaissant souvent dès le début de la maladie.
- Crampes musculaires, résultant de la perte rapide d’électrolytes.
- Dans les cas graves, une hypotension et un choc hypovolémique peuvent survenir.
Diagnostic
Le diagnostic du choléra repose principalement sur l’identification clinique des symptômes. Pour confirmer la présence de Vibrio cholerae, des tests de laboratoire sont nécessaires. Les méthodes de diagnostic incluent :
- La microscopie, bien que moins utilisée en routine.
- Les cultures bactériennes à partir d’échantillons de selles, considérées comme la méthode de référence.
- Les tests de diagnostic rapide (TDR), qui permettent une détection en quelques minutes.
Ces tests sont essentiels pour différencier le choléra d’autres maladies diarrhéiques et pour mettre en place des mesures de contrôle appropriées. La rapidité du diagnostic est fondamentale pour limiter la propagation de l’infection, surtout dans les zones à haut risque.
Stratégies de prévention et de contrôle
La prévention du choléra repose sur une série de mesures visant à limiter la transmission de Vibrio cholerae et à protéger les populations vulnérables. L’accès à une eau potable et à des infrastructures d’assainissement adéquates est fondamental pour réduire les risques d’épidémie. Dans ce contexte, des organisations comme SOLIDARITÉS INTERNATIONAL interviennent dans des zones critiques telles que la République Démocratique du Congo et le Nigéria.
Les campagnes de vaccination jouent aussi un rôle clé. En 2013, l’OMS a constitué un stock mondial de vaccins anticholériques oraux (VCO). Parmi ces vaccins, on trouve Dukoral, principalement utilisé pour les voyageurs, et Euvichol, inclus dans le stock mondial de l’OMS. Plus récemment, le vaccin Euvichol-S, simplifié, a été préqualifié début 2024.
Les efforts de prévention sont souvent coordonnés par des entités comme l’OMS et le Centre National de Référence Vibrions et Choléra de l’Institut Pasteur, qui jouent un rôle central dans la surveillance et la recherche. L’Institut Pasteur est membre de la Global Task Force on Cholera Control (GTFCC) de l’OMS, contribuant ainsi aux initiatives mondiales pour éradiquer le choléra.
Mesures d’urgence en cas d’épidémie
En cas de flambée épidémique, des mesures d’urgence doivent être déployées rapidement pour contenir la maladie. Ces mesures incluent :
- La distribution massive de solutions de réhydratation orale (SRO) pour traiter la déshydratation.
- L’augmentation de l’accès à des points d’eau potable et à des installations sanitaires temporaires.
- La mobilisation de personnel de santé pour des campagnes de sensibilisation et d’éducation sur les pratiques d’hygiène.
Les actions coordonnées de ces divers acteurs sont essentielles pour limiter l’impact des épidémies et protéger les populations à risque.