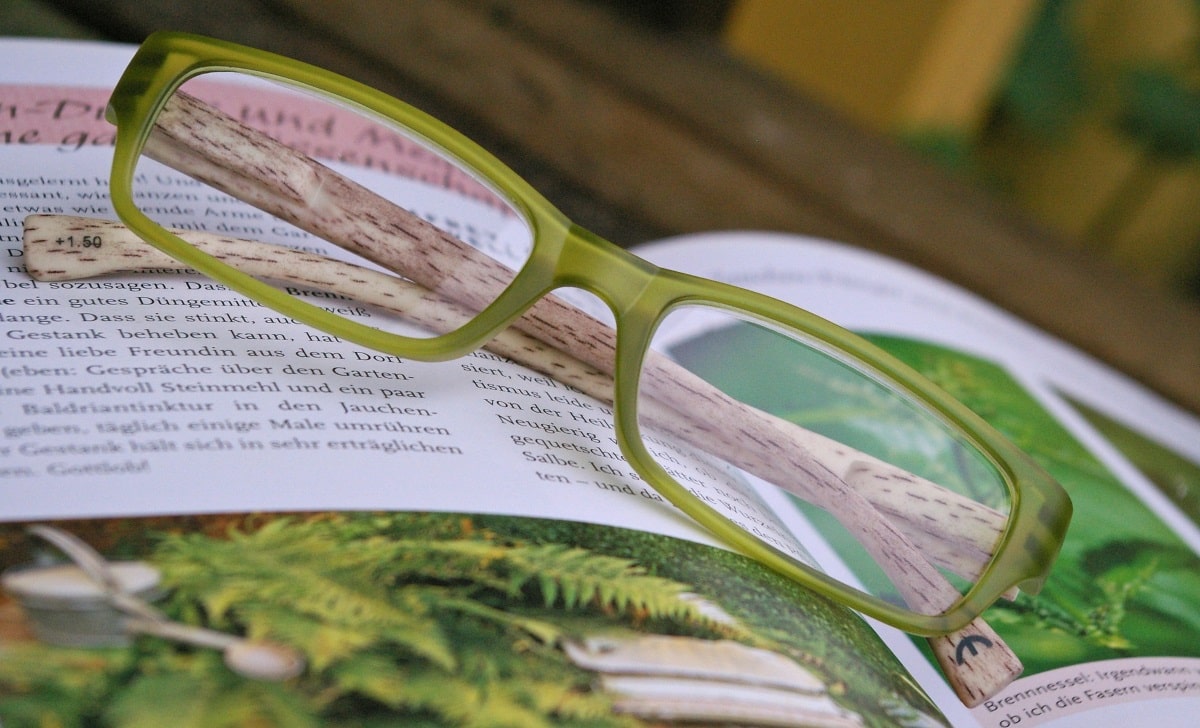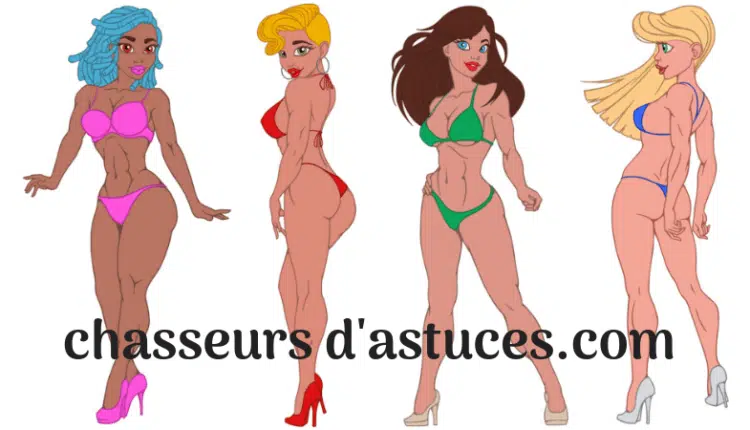En 2022, plus de 30 pays ont signalé des flambées de choléra, chiffre en hausse par rapport à la décennie précédente. Les périodes de sécheresse suivies d’inondations favorisent la réapparition de la maladie, même dans des zones ayant connu des années sans cas. Les antibiotiques, longtemps efficaces, montrent des signes de diminution d’efficacité en raison de résistances émergentes.
Les campagnes de vaccination restent limitées par la disponibilité des doses et l’accès aux populations à risque. Les infrastructures de base, notamment l’eau potable et l’assainissement, constituent le facteur clé pour enrayer durablement la propagation.
Le choléra en bref : comprendre la maladie et ses enjeux
Le choléra figure au rang des menaces infectieuses les plus surveillées au monde. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Institut Pasteur et les centres de référence scrutent son évolution avec la plus grande attention. À l’origine : une bactérie, Vibrio cholerae, qui déclenche une diarrhée aiguë, brutale, parfois fatale. Sa toxine s’attaque à l’intestin, bouleversant l’équilibre hydrique et entraînant des pertes massives d’eau et de sels minéraux.
Dans de vastes régions, le choléra n’a jamais vraiment disparu. Afrique subsaharienne, Asie du Sud, Haïti : la maladie s’ancre là où l’accès à une eau potable et à un assainissement fiables fait défaut. Dès que ces services de base flanchent, la maladie surgit, souvent violemment. Le groupe mondial de lutte contre le choléra sonne l’alarme : ces dernières années, la fréquence et l’intensité des épidémies repartent à la hausse.
Les laboratoires spécialisés passent au crible les souches de Vibrio cholerae collectées à travers le monde. Malgré la diversité génétique, seules quelques lignées virulentes sont responsables des cas graves et des grandes pandémies. La surveillance épidémiologique, orchestrée par l’OMS et ses partenaires, permet d’anticiper les nouvelles vagues et d’adapter la riposte.
Dans ce contexte mouvant, la collaboration entre agences internationales, laboratoires nationaux et acteurs de terrain est décisive. Détecter une flambée, déployer la vaccination, rétablir l’accès à l’eau ou à l’hygiène : chaque maillon compte pour contenir la maladie avant qu’elle ne s’emballe.
Quels sont les principaux facteurs à l’origine du choléra ?
La transmission du choléra se nourrit d’environnements où l’eau potable fait défaut et où les dispositifs d’assainissement restent insuffisants. La bactérie Vibrio cholerae se transmet surtout par l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Le risque s’envole après une catastrophe naturelle, dans les zones urbaines surpeuplées ou dans les contextes d’urgence humanitaire.
Les situations suivantes illustrent les principaux modes de contamination :
- Eau non traitée : puits pollués, réseaux d’eau défaillants ou points de collecte exposés aux matières fécales favorisent la prolifération bactérienne.
- Aliments contaminés : poissons, fruits de mer, légumes irrigués ou lavés avec une eau insalubre, vendus sur des marchés où l’hygiène laisse à désirer, contribuent à la diffusion du choléra.
- Hygiène insuffisante : l’absence de lavage des mains, l’inexistence ou le mauvais entretien des latrines laissent la voie libre à la bactérie.
Les équipes de Solidarités International le constatent sur le terrain : quartiers informels, camps de déplacés, zones marginalisées, autant de foyers où la promiscuité, le manque d’eau et d’installations sanitaires transforment chaque épidémie en course contre la montre. Dans ces conditions, la propagation du choléra devient difficile à enrayer sans intervention rapide et massive.
Reconnaître les symptômes et savoir quand consulter
Le choléra ne se cache pas derrière des symptômes ordinaires. Dès l’apparition d’une diarrhée aqueuse aiguë, parfois décrite comme « eau de riz », l’alerte doit être donnée. Ce signe, souvent massif et soudain, s’accompagne de vomissements et de crampes musculaires, en particulier chez l’enfant ou la personne âgée. La déshydratation peut s’installer en quelques heures : soif intense, perte de poids rapide, bouche sèche, yeux enfoncés trahissent la gravité de la situation.
Pour mieux cerner les signes à surveiller, voici les manifestations les plus fréquentes :
- Diarrhée abondante : parfois plusieurs litres d’émissions liquides en 24 heures
- Vomissements répétés
- Signes de déshydratation : fatigue, confusion, chute de la tension artérielle
Devant de tels symptômes, l’accès à une consultation médicale doit être immédiat. Toute diarrhée aiguë survenant dans une région à risque ou lors d’une épidémie impose une prise en charge sans délai. Les équipes du centre national de référence rappellent que la survie dépend de la rapidité de la réhydratation orale ou intraveineuse. Sans intervention, les plus vulnérables courent un danger vital.
Le diagnostic s’appuie d’abord sur l’examen clinique, mais l’isolement de la bactérie Vibrio cholerae par culture reste la méthode de référence pour confirmer la maladie. Les consignes de l’Organisation mondiale de la santé et de l’Institut Pasteur soulignent la nécessité d’une vigilance accrue, surtout dans les régions où le choléra frappe encore régulièrement.
Prévenir l’infection : conseils pratiques et mesures essentielles
La prévention du choléra se concentre sur l’ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. La vigilance doit être maximale : dans les zones à risque, il est impératif de ne jamais boire d’eau non traitée. Privilégiez toujours l’eau bouillie, filtrée ou embouteillée, et évitez les glaçons d’origine douteuse. L’hygiène des mains reste une barrière simple et puissante, à pratiquer systématiquement avant chaque repas ou manipulation d’aliments.
Certaines pratiques, accessibles à tous, réduisent considérablement le risque de transmission :
- Désinfectez toujours l’eau utilisée pour boire ou cuisiner.
- Lavez-vous soigneusement les mains après chaque passage aux toilettes et avant de toucher à la nourriture.
- Consommez des aliments bien cuits et surveillez leur conservation, notamment pour les produits de la mer.
Les collectivités ont aussi un rôle majeur à jouer : investissement dans des installations sanitaires adaptées, gestion rigoureuse des eaux usées, programmes d’éducation à l’hygiène. L’accès à des infrastructures fiables protège efficacement la population.
La vaccination anticholérique complète la panoplie de prévention, notamment lors d’épidémies ou pour les groupes les plus exposés. L’OMS recommande les vaccins oraux en contexte de risque élevé. Les personnels de santé, souvent en première ligne, sont particulièrement concernés par cette protection complémentaire.
L’information, la mobilisation communautaire et la vaccination sont les piliers qui permettent de contenir, puis d’endiguer le choléra. Là où ces mesures convergent, la maladie recule. Mais là où elles font défaut, le choléra rappelle sa capacité à frapper vite, et fort.